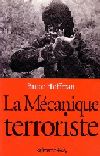
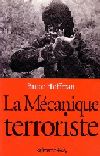 |
|
Bruce Hoffman dirige le bureau washingtonien de la Rand Corporation, centre de recherche qui travaille sur le terrorisme et les conflits de basse intensité. Il rapporte une conversation entre Terry Anderson, journaliste américain otage, pendant près de sept ans, du Hezbollah libanais, et l'un de ses geôliers. Ce dernier dénonce l'utilisation de l'adjectif " terroriste " utilisé par la presse occidentale pour qualifier son parti, et affirme avec véhémence : "Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des combattants. " Et Anderson de lui répondre : " Tu es un terroriste, vérifie dans le dictionnaire. Tu es un terroriste, même si tu n'aimes pas le mot et si tu n'aimes pas le mot, ne commets pas l'acte."
On appelle terroriste celui qui recourt à la terreur pour
tenter d'imposer sa volonté sur la scène politique.
Le paradoxe, c'est qu'en le désignant par son nom, on
émet également un jugement de valeur. Car subjectivement,
le terroriste, c'est "l'autre" : l'israélien,
pour les hommes du Hezbollah ou du Hamas l'Etat français,
naguère, aux yeux des assassins du FLN; les Etats-Unis
pour le milliardaire saoudien Oussama Ben Laden, commanditaire
d'attentats anti-américains actuellement réfugié
en Afghanistan. Bref, en choisissant d'employer le terme "terroriste
", on s'interdit toute neutralité. On a vu, au mois
de mars, ce qu'il en a coûté à Lionel Jospin
d'oublier cette réalité, à propos du Hezbollah
justement. Il a dit ce qu'il avait raison de penser, mais tort
d'exprimer.
Quoi qu'il en soit, cette définition qui réduit
le terrorisme à l'usage de la terreur n'est guère
satisfaisante. Les Etats en guerre ne cherchent-ils pas, eux
aussi, à "terroriser" l'ennemi ? Les bombardements
sur Dresde ou l'usage de l'arme nucléaire contre le Japon,
à la fin du dernier conflit mondial, relèvent de
cette logique. Et les groupes terroristes ne s'y trompent pas,
qui se servent de cette analogie pour banaliser leurs actes et
revendiquer une légitimité militaire.
Ils n'oublient qu'une chose : c'est qu'il existe des règles
de la guerre. Déjà, au Moyen-âge, on préconisait
leur respect à défaut de les appliquer toujours.
Au XIIe siècle, le juriste hollandais Hugo Grotius les
énonça avec clarté et, à partir de
1860, plusieurs conventions sur les conflits armés, signées
à Genève et à La Haye, les transformèrent
en lois internationales.
Que dit cette législation supra-nationale? Elle interdit
de prendre des civils en otages, édicte des principes relatifs
aux droits des prisonniers de guerre, prohibe les représailles,
conceptualise la notion de " territoire neutre " et
la protection des diplomates. Bruce Hoffman constate qu'un "survol
même rapide des activités terroristes du dernier
quart de siècle, de leurs tactiques et de leurs cibles,
montre que les terroristes ont violé toutes ces
règles". En s'affranchissant, dans leur lutte, des
lois de la guerre, les terroristes se retranchent du champ militaire.
Dès lors, et quelle que soit la légitimité
de leur cause, ils ne sont plus que des assassins.
Certes, trop souvent, les Etats eux-mêmes, fussent-ils occidentaux,
violent le droit de la guerre. Mais là apparaît la
différence avec les organisations terroristes les Etats
sont, de plus en plus, obligés de rendre des comptes. Et
lorsque leur mépris des lois de la guerre devient un mode
de fonctionnement courant, ils finissent par être relégués
dans la catégorie "Etats terroristes", isolés
par la communauté mondiale. Il n'est que de songer à
la Libye, au Soudan ou à l'Iran.
Ostracisé, le terrorisme n'en continue pas moins d'exister.
Dans un monde où le développement des techniques
donne l'avantage aux armées régulières sur
les guérillas, il tend à se substituer à
ces dernières et fait figure d'ultime "réponse
du faible au fort".
Or la modernité, en multipliant
les contraintes réglementaires, engendre de plus en plus
de frustrations. Bruce Hoffmann s'en inquiète et suggère"
d'établir un pont entre la société et
les extrémistes ". En clair, même s'il ne
le dit pas en ces termes, il suggère de renforcer la
démocratie, afin d'éviter que l'on atteigne
le point de rupture psychologique à partir duquel
un groupe de personnes frustrées se mue en organisation
terroriste.
Comme le remarque Gérard Chaliand dans la préface
de l'ouvrage, le terrorisme "ne peut pas déstabiliser
les Etats industriels mais représente une nuisance dont
l'impact, dans les esprits, est important ". Et Chaliand
de conclure son propos en se demandant si le terrorisme n'est
pas le prix que doit payer l'Occident pour son hégémonie
planétaire. C'est-à-dire pour le manque de démocratie
qui caractérise la scène internationale.